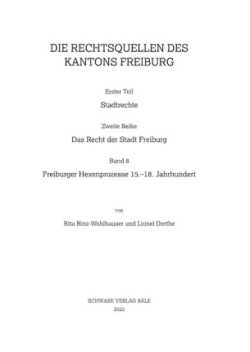Avant tout, disons que ce double volume demande une certaine prise de distance. Comment en effet ne pas s’indigner devant la mort sur le bûcher, avec ou sans «mitigation» de peine, de tant de personnes pour le crime imaginaire de sorcellerie? Et même si le bûcher ne représente «que» 22 % de l’issue des procès, comment ne pas compatir au sort des autres personnes qui ont été torturées et qui, si elles ont été relaxées et souvent bannies ou confinées, ont dû payer les frais de justice? Passée cette mise au point, avouons que l’édition en question est d’un intérêt prodigieux pour qui s’intéresse à l’histoire de la sorcellerie ou plus généralement à la vie quotidienne fribourgeoise. Que les éditeurs en soient remerciés.
Le double volume édite les procès tenus dans la ville de Fribourg, depuis celui de Jeannette Lasne en 1493 à celui de Marguerite Repond en 1741, en se fondant sur les actes de procédure du tribunal (les Thurnrodel) et les manuaux du conseil de la ville. Il ne prend pas en compte ceux des bailliages, ce qui serait une autre aventure éditoriale, que nous appelons de nos vœux. En vérité la première sorcière condamnée à Fribourg serait Itha Stucki, une femme de la Singine, qui en 1442 comparaît pour la troisième fois devant le tribunal et est brûlée vive avec son fils Peter, mais son procès est antérieur au premier Thurnrodel. Quant à la dernière sorcière, ce n’est pas Catherine Repond, connue sous le surnom de Catillon, mais sa sœur Marguerite. Si Catillon est bien la dernière sorcière à avoir été condamnée et brûlée dans le canton en 1731, Marguerite, déjà inquiétée avec elle, aura «droit» à un nouveau procès dix ans plus tard. L’inculpée mourra la veille de sa condamnation.
Les procès sont écrits en français ou en allemand. Il est difficile de savoir si les accusés parlaient en ces langues ou si on a retranscrit les patois qu’ils utilisaient. Les procédures impliquent souvent plusieurs individus, lesquels peuvent aussi passer plusieurs fois devant la justice. Tout en sachant que la série des Thurnrodel n’est pas complète, les éditeurs ont pu identifier 309 personnes, dont deux tiers de femmes, et 360 procès. La majorité d’entre eux ont lieu entre la fin du XVIe siècle et le deuxième tiers du XVIIe siècle, avec certains pics. On dénombre ainsi 28 procès durant la seule année 1623 et 120, un chiffre énorme, durant la décennie 1643–1652.
Même si certains accusés pratiquaient des activités en marge comme la récolte d’herbes et l’usage de prières magico-religieuses, précisons que la sorcellerie et le sabbat décrits dans les procès n’ont jamais existé. C’est un univers imaginaire forgé au début du XVe siècle. Les accusés avouaient pourtant de tels méfaits, mais sous la contrainte de la torture. Il est bien connu qu’avec la torture, l’accusé avoue n’importe quoi, alors que le nonaveu est plutôt le prix, non de la bonne conscience, mais de l’endurance devant les tourments. Comment les juges ontils pu penser le contraire? Ils auraient dû réfléchir aux paroles de certains accusés, à Jean Monneron disant en 1623 que ce qu’il avait avoué, il le fut «contrainct par la torture, qu’il ne pouvoit plus endurer» (p. 322), ou à Margret Schueller-Python expliquant en 1629 que son aveu «estoit pas vray, ains contrainct par le tourment» (p. 369). En 1683 encore, Maria Duchêne-Ribotel avouait que «tantost elle at dit qu’elle avoit faict lesdites confessions par crainte de desplaire et d’offencer monsieur le bourgermeister et aultres seigneurs de la justice» (p. 1251). L’intérêt de se sentir écouté en aurait poussé peut-être d’autres à en rajouter, comme le très jeune Claude Bernard, douze ans, qui en 1651 avoue coup sur coup plusieurs meurtres (p. 1003–1005). L’aurait-il fait par jeu et/ou par désir de se mettre en avant?
Le narratif autour du sabbat obéit volontiers à un schéma assez répétitif qui globalement, est le suivant: épisode dépressif du futur sorcier, apparition d’un inconnu, très souvent appelé Gabriel, promettant richesse et bonheur à qui reniera Dieu, hésitation puis accord du futur sorcier, don de pièces d’argent qui deviendront des feuilles, participation au sabbat (appelé plutôt secte ou synagogue). Le sabbat, où l’on ne vient guère sur un balai volant, s’avère plutôt morne. Souvent, les accusés prétendent ne pas connaître les autres participants. Il faut baiser le derrière du maître, mais la dimension orgiaque n’est guère développée. Les sorciers ont reçu du pous-set (de la poudre) et de la graisse pour faire périr gens et bêtes. Ils se spécialisent dans la fabrication de la grêle et le vol magique du lait, en attirant pour leurs vaches le lait des vaches d’autrui. Il est aussi question de transformations animales.
Le laconisme des procès-verbaux ne permet pas de tout comprendre. Les juges soufflaient-ils aux accusés les réponses qu’ils attendaient? Ou bien les accusés partageaient-ils avec les juges un même imaginaire? Quelques accusés nient avoir des accointances diaboliques mais mentionnent des apparitions de fantômes ou d’êtres célestes, comme Maria Duchêne-Ribotel déjà nommée, qui aurait vu «Nostre Dame toutte blanche», et un autre jour «at dit que elle at veuz proche d’une haye à Balleswyl une jolie petite ame toutte blanche, et croit que soit l’ame de son enfant» (p. 1226–1227). Ces personnes vivaient donc dans un univers saturé de surnaturel. Elles auraient été ainsi plus disponibles à entrer dans le jeu de leurs juges. En outre, il faudrait se demander dans quelle mesure les procédures, et aussi l’imaginaire du sabbat qu’elles véhiculaient, étaient connus du public et quelque peu adoptés par lui. En 1676 par exemple Clauda Andrey-Centlivres, menacée de la torture et cherchant vraisemblablement à gagner du temps, demande à ce qu’on recherche sur son corps la marque diabolique, parce «c’estoit pourtant la coustume, l’ayant entendu dire d’une femme d’Estavayer, qui avoit eu une sœur entre les mains de la justice trois fois» (p. 1188).
Le temps manque pour aborder d’autres problématiques, notamment celle de la périodisation des procès en sorcellerie à Fribourg (cf. p. CXXXII). Il faudrait aussi chercher à connaître la cause des procès. Des conditions économiques, climatiques ou politiques défavorables, ou des drames singuliers comme un décès insolite ou le faible rendement du troupeau, expliquent sans doute le déclenchement des procédures, parce qu’on devait trouver des coupables. La malveillance, l’esprit de vengeance, et l’accusation de pseudo-complices par des personnes déjà impliquées auraient fait le reste. Les éditeurs notent que «le concours des juges et de la population est nécessaire pour passer d’une suspicion de sorcellerie à une accusation» (p. CXX). Enfin, on pourrait chercher l’origine sociale des accusés. Etaient-ils pour beaucoup de condition modeste et des mendiants? Peut-être, mais ce qui nous a frappé est la mobilité des personnes, mobilité linguistique et même confessionnelle, leurs déplacements dans et hors du canton. Ces mobilités mettent à mal l’image d’une société fribourgeoise ancienne qu’on pourrait croire fixiste.
A côté de l’histoire de la sorcellerie en pays de Fribourg, le livre offre un instantané sur la vie de ses habitants. On trouvera diverses informations sur leur alimentation, leurs activités professionnelles et leurs outils, leurs relations familiales, leur vie sexuelle pas toujours fidèle aux normes du temps, leurs croyances et leurs pratiques religieuses, notamment les pèlerinages ou l’usage de prières magico-religieuses, leurs maladies, etc. La toponymie y est très développée. Beaucoup de noms sont connus où les accusés prétendent avoir rencontré l’esprit malin, assisté à la secte ou pratiqué des sortilèges, mais d’autres vont exercer la sagacité des spécialistes, comme cette mystérieuse fontaine des Assiliettes aux alentours du Gibloux, qui apparaît très souvent. Enfin redisons que les procès sont édités en deux langues, l’allemand ou le français. Mais les textes fourmillent de mots locaux, qui ne sont pas toujours aisés à comprendre. A côté des index des noms de personnes et de lieux, un volumineux glossaire de 76 pages aide heureusement à s’y repérer.
Zitierweise:
Rime, Jacques: Rezension zu: Binz-Wohlhauser, Rita; Dorthe, Lionel (Hg.): Freiburger Hexenprozesse 15.–18. Jahrhundert (Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen. IX. Abteilung: Die Rechtsquellen des Kantons Freiburg. I. Teil: Stadtrechte. II. Reihe: Das Recht der Stadt Freiburg. Band 8/1 + 2), Basel, 2022. Zuerst erschienen in: Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, Vol. 117, 2023, S. 438-440. Online: https://doi.org/10.24894/2673-3641.00155.